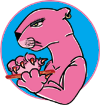Dans le même dossier
- Autocollants
- Panthères roses mode d’emploi
- Tribune AL
- trans-gouine-pédé-mestriel des Panthères roses
- Violences et milieu militant
- Petit manuel à l’usage des manifestants et activistes
- Retrouvez les classiques, découvrez les nouveautés
- Crédits
- Tract
- FSE
- Appel à dons
- Pour soutenir nos actions
- Tribune
- Interview collective
Nous sommes féministes
La Bibliothèque publique d’information de Beaubourg (BPI) a organisé à Paris pour la deuxième année consécutive les 1er et 2 avril 2005 un colloque sur les féminismes. Les Panthères roses étaient invitées à la table ronde « Nouvelles formes de mobilisation : les féminismes face aux discriminations ». Ce texte a été élaboré pour cette occasion. Comme nous avions vu grand, plusieurs parties n’ont pas été abordées à ce moment là. Ils nous paraissent néanmoins faire le point sur certains aspects de notre positionnement et de nos réflexions, c’est pourquoi nous présentons ici une version « longue ».
Ce texte est dédié à Torvald Patterson, militant, queer, prostitué, malade du sida, cuir, féministe, marxiste... Il est mort jeudi 31 mars 2005.
1. Présentation
Les Panthères roses existent à Paris depuis début 2003. Nous sommes une trentaine de militantEs à nous rencontrer régulièrement, une cinquantaine moins régulièrement et plus de 700 personnes reçoivent nos courriers électroniques.
Des assemblées générales publiques hebdomadaires sont l’instance de décision (nous n’avons ni présidentE, ni bureau). Des commissions de travail ouvertes préparent les sujets qui sont discutés en assemblée : action ponctuelle, élaboration d’un positionnement, gestion de l’association, projets de long terme...
Nous sommes une association de gouines et de pédés, à majorité gouine.
Nous intervenons et réfléchissons depuis ce point de vue, mais pas seulement, car nous sommes aussi salariéEs, chômeuSEs et précaires, socialement femmes et hommes, noirEs, blancHEs, immigréEs... mais aucunE d’entre nous n’est homme blanc catholique hétérosexuel riche et en bonne santé.
Nos préoccupations sont multiples parce qu’il est impossible de démêler les uns des autres les mécanismes d’oppression, de domination et d’exploitation : ils interfèrent et agissent de façon croisée sur les individus.
Différents systèmes d’oppression existent, parallèles et connectés. Toutes les femmes subissent l’hétéropatriarcat, qui existe en parallèle du système de classe. Les différences sociales interfèrent : même si le droit de disposer de son corps est un enjeu pour toutes les femmes, une jeune fille parisienne de milieu favorisé peut facilement savoir que le Planning familial existe. Elle a un point d’avance sur une jeune provinciale isolée.
L’hétéropatriarcat est un système qui instaure la hiérarchie entre les sexes. Il définit d’abord deux genres, masculin et féminin. Puis il explique comment ces deux genres doivent aller ensemble, c’est l’hétérosexualité obligatoire. Ce système vise à ce que les femmes restent à leur place - c’est le sexisme - et à faire taire les désirs des pervers - c’est l’homophobie.
Un seul système donc, plusieurs effets !
Ce système n’est pas isolé des autres : quand le gouvernement casse les retraites en 2003, Chirac fait un grand discours sur les solidarités familiales. Hétéropatriarcat et politique libérale font visiblement bon ménage...
Nos priorités politiques sont aujourd’hui :
![]() Faire connaître des « détails » qui passent facilement à la trappe : lorsque la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) explique que le sexisme et l’homophobie sont une liberté d’expression... lorsqu’une député européenne homophobe et sexiste est élue a la direction de la commission des droits des femmes avec les votes du PS... Nous réagissons, nous tentons de médiatiser, nous résistons à l’évidence.
Faire connaître des « détails » qui passent facilement à la trappe : lorsque la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) explique que le sexisme et l’homophobie sont une liberté d’expression... lorsqu’une député européenne homophobe et sexiste est élue a la direction de la commission des droits des femmes avec les votes du PS... Nous réagissons, nous tentons de médiatiser, nous résistons à l’évidence.
![]() La visibilité au quotidien est un enjeu, nous menons des actions de visibilité. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous supposéEs être hétéro. Quand les gays et des lesbiennes sont « acceptés », c’est toujours à condition de discrétion. Nous ne sommes pas discrètes !
La visibilité au quotidien est un enjeu, nous menons des actions de visibilité. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous supposéEs être hétéro. Quand les gays et des lesbiennes sont « acceptés », c’est toujours à condition de discrétion. Nous ne sommes pas discrètes !
![]() Nous participons aux manifestations sur les thématiques féministes, autour du genre et de la sexualité. Mais les premières auxquelles nous avons participées protestaient contre la guerre en Irak. Puis nous avons manifesté pour les Sans-papiers, pour le service public... Ces présences prennent des sens différents. Contre la guerre, nous étions effectivement opposéEs à cette guerre. Et quand nous disions "Le pétrole on s’en fout, nous on roule à pédale !", nous faisions un pôle de visiblité LGBT. Notre présence pour la défense des services publics est motivée par notre conviction qu’être gay ou lesbienne ne nous soustrait pas aux réalités sociales. Bien au contraire dans certains cas...
Nous participons aux manifestations sur les thématiques féministes, autour du genre et de la sexualité. Mais les premières auxquelles nous avons participées protestaient contre la guerre en Irak. Puis nous avons manifesté pour les Sans-papiers, pour le service public... Ces présences prennent des sens différents. Contre la guerre, nous étions effectivement opposéEs à cette guerre. Et quand nous disions "Le pétrole on s’en fout, nous on roule à pédale !", nous faisions un pôle de visiblité LGBT. Notre présence pour la défense des services publics est motivée par notre conviction qu’être gay ou lesbienne ne nous soustrait pas aux réalités sociales. Bien au contraire dans certains cas...
![]() Nous sommes un groupe gouine et pédé en non mixité homo parce que nous croyons à l’efficacité de la non mixité. Nous n’avons pas pour autant une démarche séparatiste et nous travaillons en réseau avec des lesbiennes en non mixité de genre, des féministes, des antiracistes, des immigrés, des altermondialistes....
Nous sommes un groupe gouine et pédé en non mixité homo parce que nous croyons à l’efficacité de la non mixité. Nous n’avons pas pour autant une démarche séparatiste et nous travaillons en réseau avec des lesbiennes en non mixité de genre, des féministes, des antiracistes, des immigrés, des altermondialistes....
![]() Le monde dans le quel on vit ne nous va pas ! Résister, c’est aussi créer des espaces alternatifs d’expérimentations sociales, amicales, culturelles, artistiques, sexuelles... : restaurant associatif, préparation des Universités euroméditerranéenne d’été des homosexualités (UEEH)...
Le monde dans le quel on vit ne nous va pas ! Résister, c’est aussi créer des espaces alternatifs d’expérimentations sociales, amicales, culturelles, artistiques, sexuelles... : restaurant associatif, préparation des Universités euroméditerranéenne d’été des homosexualités (UEEH)...
Les formes de contestation que nous utilisons ne sont pas nouvelles : irrévérence devant le sacré, insolence parfois, humour, colère... tout ça a déjà été utilisé par d’autres avant nous et autour de nous aujourd’hui. Bref, l’oubli est passé par là, on n’invente pas grand chose. Et il est vrai que l’oubli de ce qui gêne a une fonction politique...
2. Positionnement : deux paradoxes et demi
Pour compléter cette présentation factuelle, nous aborderons 2 paradoxes et demi qui font partie des fondamentaux de notre positionnement politique :
1. Nous mettons en cause les genres masculin et féminin, c’est à dire qu’on cherche à le démolir le système de genre, et, en même temps, nous reconnaissons l’existence des femmes en tant que catégorie opprimée, ce qui nécessite un combat spécifique.
2. Nous voulons abolir les genres. Que dire alors de nos attirances pour des personnes de même sexe ?
3. Une association féministe de gouines et de pédés : ça n’a rien de naturel !
2.1. Ce qui peut apparaître comme un paradoxe "Remettre en cause le genre et reconnaître l’existence des femmes en tant que catégorie opprimée"
La hiérarchie entre les sexes s’appuie sur l’existence et la définition des genres : c’est la création de catégories à partir de critères précis qui fondent la différence. Comme le choix des critères est opéré à partir d’un référentiel dominant - le plus souvent estampillé "naturel" - la différence ainsi constituée est un mécanisme d’oppression : c’est sa fonction intrinsèque. Partant de là, la contestation du genre s’articule directement avec la reconnaissance de l’oppression des femmes et la lutte contre le sexisme et ses effets.
Nous refusons l’identification à un homme ou une femme : nous ne sommes ni l’un ni l’autre parce que nous refusons l’assignation à la féminité ou à la virilité. Au fond, ce que nous refusons c’est la hiérarchie qui découle de ce binarisme et l’aliénation qui l’accompagne, le manque d’inventions et d’expérimentations dans ces deux modèles très étriqués. En même temps, nous sommes féministes, parce que les femmes existent vraiment en tant que personnes discriminées. La discrimination c’est un traitement différent, un truc qui sert à distinguer... depuis le point de vue dominant.
Ce point de départ a des conséquences sur la façon d’aborder les choses. Par exemple, les droits à la contraception et à l’IVG ne sont pas dissociables de l’assignation du genre féminin à la maternité. La lutte pour ces droits doit se penser sans perdre de vue le cadre dans lequel il se situe : l’horizon est l’abolition de la féminité comme construction politique. Il nous paraît important de dire les deux aspects, sans minimiser l’un ou l’autre. L’objectif de la libération des femmes doit sans cesse travailler sur plusieurs niveaux : il faut gérer les situations concrètes souvent dramatiques et, en même temps, il faut expliquer les mécanismes d’oppression. Dire que ce n’est pas une situation "pour toujours", qu’on peut agir pour changer la réalité, nécessite de mobiliser plusieurs outils : l’exigence de droits, l’exigence de lois qui protègent les femmes et aussi la mise en mouvement des imaginations, l’ouverture des possibles...
Les formes de mobilisation sont aussi touchées par ce point de départ. La prise de parole doit s’opérer, ce qui n’est pas nouveau, mais elle peut être diverses et apparemment contradictoire. Quand on dit par exemple : "les femmes doivent disposer de leur corps" et, à un autre moment, "je suis lesbienne et pas une femme", cela signifie que nous articulons deux niveaux de discours répondant à différents niveaux du sexisme.
Sur le discours encore, la mise en perspective engage vers des propositions complètes. Prenons par exemple le slogan bien connu "Quand une femme dit non, c’est non". Le discours en creux n’est pas dit : que se passe-t-il si elle dit oui ou si elle propose ? Quand on exige la liberté de choix - la possibilité de dire non - l’ouverture du possible implique d’affirmer en même temps qu’une femme a aussi le droit de proposer, de dire oui, bref, d’être une salope. On exprime alors une absence de jugement sur ses choix, et c’est important aussi.
2.2. L’abolition des genres et nos attirances pour des personnes de même sexe
Gouines et pédés, certes nous le sommes. Mais nous ne sommes pas des super-héros sortis d’hétéromacholand ! Nous sommes construitEs, névroséEs, aliénéEs... aussi. Par contre, nous déconstruisons certaines évidences, le naturel et autres ordres symboliques qui sont des outils pour les dominations variées qui nous cernent.
Nous ne faisons pas ça par plaisir, c’est un moyen de combattre les relations de domination et d’ouvrir des possibles.
On travaille à savoir ce qui nous domine, dans le quotidien, l’intime et le public. Mais ce n’est pas parce qu’on comprend certaines choses qu’on s’oblige et qu’on oblige quiconque à tenir une conduite "libérée" ! Nous vivons ce mécanisme d’assignation à des conduites qui ne nous vont pas du tout, nous ne sommes pas prêtes à le répéter...
Comme nous sommes obligéEs de réfléchir à nos sexualités anormales qui sont sans cesse distinguées, réprouvées, etc., nous en profitons pour expérimenter des trucs, y compris des choses qui peuvent paraître bizarres ou excessives : pratiques sexuelles diverses, vêtements, manières... En un mot, contraintEs de passer au crible nos anomalies qui nous sont jetées à la figure avec mépris, nous prenons conscience de nos choix, de nos goûts et des possibles dont nos papa et maman ne nous ont pas parlés. C’est un privilège de l’anormalité...
Les lesbiennes profitent aussi d’un espace allégé du regard et de l’appropriation masculine. Même si on ne croit pas qu’on puisse totalement s’extraire du sexisme, il faut reconnaître que les relations entre lesbiennes sont propices à des échanges moins inégalitaires que les relations hétérosexuelles. Une expérience lesbienne, extraite du regard et de la possession des hommes, permet de vivre, et donc d’imaginer, d’autres formes d’existence.
Les pédés peuvent aussi parler de tout ça, avec un point de vue diffèrent sur certains aspects.
Pour lever toute ambiguïté, nous tenons à dire que nous n’opérons pas de hiérarchie entre les sexualités. C’est à dire qu’une relation hétérosexuelle est aussi valide et légitime qu’une relation homosexuelle. Mais l’inverse aussi devrait être vrai, ce qui n’est pas du tout le cas... Reconnaître nos expériences originales contribue à montrer qu’unE autre monde est possible. Nous nous employons à le faire savoir.
Dernière "petite" chose : il existe une grande différence entre des normes qui oppressent la moitié de l’humanité au moins et des pratique qui n’embêtent personne ! Quelque soit nos conduites sexuelles, dès lors qu’elles ont lieu avec respect et écoute, elle ne font aucun mal à autrui. Plus précisément, nous n’avons aucune préférence collective et nous ne portons pas de jugement sur les pratiques sado-masochistes, l’utilisation ou non de jouets sexuels par les unEs et les autres, la fidélité ou l’infidélité, le couple ou le célibat ou les amours multiples, le sexe avec ou sans amour... Mais rien ne nous empêche d’en parler, de dire que ça existe, que ce n’est ni bien ni mal et qu’il revient à chacunE de choisir.
2.3. Une association féministe de gouines et de pédés, c’est pas naturel
La négation et l’invisibilisation des lesbiennes n’est pas équivalente au dégoût de l’homosexualité masculine. Par exemple, l’homoparentalité serait peut-être acceptable si elle ne concernait que les lesbiennes (naturellement maternelles, voir pour cela le traitement des lesbiennes à la télé très souvent mères....).
Même si les gouines et les pédés partagent l’hétéropatriarcat - racines de nombreux maux -, il ne s’exprime pas toujours de la même manière. Les gouines sont socialement vues comme des femmes : nous vivons les salaires "féminins", l’espace public colonisé par les hommes, la possession des femmes par les hommes (violences verbales et physiques), la dépréciation, etc. Et l’invisibilité n’a pas les mêmes effets que l’opprobre jetés sur les non-hommes.
Par conséquence, les formes de résistance aux diverses discriminations ne sont pas les mêmes.
D’autre part, il n’y a pas d’évidence à la conscience des autres discriminations, donc pas d’évidence à la mise en place de stratégies communes.
Alors pourquoi des gouines et des pédés s’associent pour lutter ensemble ?
Des points communs permettent l’association :
![]() L’hétérosexualité définit des genres. Dans une certaine mesure, nous partageons le sexisme : les pédés sont moins bénéficiaires que des vrais hommes du système de domination. Non seulement ils lavent leur linge et font la cuisine - ce qui n’est déjà pas si mal comme expérience - mais surtout on les accable de honte pour la raison qu’ils fuient leurs responsabilités de géniteur.
L’hétérosexualité définit des genres. Dans une certaine mesure, nous partageons le sexisme : les pédés sont moins bénéficiaires que des vrais hommes du système de domination. Non seulement ils lavent leur linge et font la cuisine - ce qui n’est déjà pas si mal comme expérience - mais surtout on les accable de honte pour la raison qu’ils fuient leurs responsabilités de géniteur.
![]() Le système de la normalité sexuelle s’exprime parfois de la même façon : nous partageons les mêmes discriminations légales par exemple. L’inégalité de droits basée sur l’orientation sexuelle (mariage, parentalité...), le statut des personnes célibataires relativement aux personnes mariées en sont des exemples.
Le système de la normalité sexuelle s’exprime parfois de la même façon : nous partageons les mêmes discriminations légales par exemple. L’inégalité de droits basée sur l’orientation sexuelle (mariage, parentalité...), le statut des personnes célibataires relativement aux personnes mariées en sont des exemples.
![]() L’origine de la répression de nos modes de vie vient de nos sexualités. Cette intrusion dans l’intime n’est pas une mince affaire, les féministes qui clament que le privé est politique en savent quelque chose.
L’origine de la répression de nos modes de vie vient de nos sexualités. Cette intrusion dans l’intime n’est pas une mince affaire, les féministes qui clament que le privé est politique en savent quelque chose.
Nous sommes des perversEs ! Même si les lesbiennes sont plus souvent invisibilisées que stigmatisées, cette classification des sexologues de la fin du 19e siècle décrit toutes celles et ceux qui n’ont pas la sexualité adéquate. Nous sommes des « rebelles sexuelles », des individus dont la sexualité n’est pas celle qu’il faut et qui en ont fait une affirmation, un truc central, un truc volontairement à expérimenter, à interroger, une base de départ pour des réflexions politiques, des travaux artistiques...
Comme cette association gouines et pédés n’a rien d’évidente, elle doit être travaillée.
On vise l’abolition des genres et pas simplement la réappropriation de l’autre genre, le retournement ou même l’ambivalence. Aujourd’hui nous nous distinguons gouines et pédés. Pédégouine en un seul mot est un horizon, une utopie... mais il faut reconnaître et faire savoir que les gouines et les pédés ne sont pas traitéEs de la même façon, qu’ELLEs ne partagent pas les mêmes expériences même si quelques unes sont communes. La prise en compte de la spécificité de nos oppressions est un facteur déterminant.
En plus des réflexions et actions publiques, nos comportements quotidiens doivent traduire cette prise en compte.
La mixité de genre des Panthères roses ne s’est pas faite toute seule. C’est une volonté qui s’est traduite concrètement par des moments en non mixité de genre, des travaux collectifs spécifiques sur l’oppression des lesbiennes, des pratiques de groupe réfléchies, travaillées et remises en question sur la prise de parole, l’écoute, etc.
Conclusion : les paradoxes ne nous empêchent pas d’agir, bien au contraire, ils sont moteurs !
3. Identité par le retournement de l’insulte et sa réappropriation
Prenons un de nos slogans : "Nous sommes fières, nous sommes gouines, nous sommes moches et masculines". C’est un cri contre la sacralisation d’UNE beauté, de LA féminité... et c’est une affirmation politique. Nous reprenons le poncif de la masculinité qui conduit inévitablement à la laideur, sous entendu pour une femme, évidemment.
Nous exprimons le refus de la dualité de genre et la possibilité de transgression. Pourtant, le cheminement pour passer de femmes à gouine n’est pas une balade tranquille ! La jeune camionneuse vêtue de pantalons larges et aux cheveux ras qui, entendant sa mère, ses collègues et le patron du bistrot du coin répéter que non, vraiment, ce n’est pas joli, doit vaincre maints courants, extérieurs et intérieurs pour se trouver belle, intéressante et désirable. La déprime - voire le suicide - ou, plus simplement, le mariage et les gosses "quand même" sont des issues possibles contre lesquelles il faut s’armer.
Vous nous direz que c’est le cas de tout le monde, et c’est effectivement vrai pour la plupart des femmes. Mais, de par sa position si éloignée de ce qu’on attend d’elle, et surtout le constat qu’il est super difficile, voire impossible, de revenir dans le droit chemin de la féminité hétérosexuelle, la nécessité de créer une alternative peut apparaître.
Nous refusons la position de victime. Non pas qu’il n’y en ait pas, le sexisme et l’homophobie font des victimes, mais s’il est indispensable d’accueillir les victimes (un niveau) il faut, en même temps, retourner la violence et la ridiculiser (autre niveau). La fierté devient une arme, la visibilité aussi. L’humour et le retournement de l’insulte sont des stratégies qui permettent de construire sa propre identité. Mais malgré des résistances individuelles, une collectivité politique est utile pour y parvenir parce que rien n’est automatique. C’est pour ça que l’affirmation et la fierté collective sont nécessaires. C’est aussi pour ça que la communauté tant décriée est un mieux contre l’isolement.
4. Prostitution, voile et délimitation du féminisme
Les questions qui nous sont posées afin que nous précisions nos positions à propos de la prostitution et du "voile" semblent viser à nous agréer ou non en tant que féministes. Les enjeux du féminisme seraient donc réduits à ces deux points ?
Une question posée aujourd’hui au féminisme est la transmission. Or transmettre c’est perdre, lâcher du pouvoir, écouter et reconnaître ce qui est fait par des groupes dont les influences politiques et les expériences sont multiples et excèdent parfois certains courants féministes.
Nous n’avons pas de position définitive sur la prostitution. Nous débattons à l’intérieur du groupe, nous ne sommes pas en mesure de nous dire abolitionniste, réglementariste... ou autrement. Par contre, nous sommes d’accord sur la reconnaissance du droit des prostituées à s’organiser. Leurs paroles, en tant que personnes directement concernées, sont légitimes et doivent être écoutées. Leurs revendications émanent de leurs conditions de vie, cela nous suffit pour leur faire confiance et débattre avec elles des objectifs et des stratégies à mettre en place.
Sur le voile. Qui demande ou a jamais demandé aux femmes mariées de renoncer à l’aliénation du mariage pour « rentrer en féminisme » ? Car, s’il fallait être libéréE de toute aliénation sexiste pour avoir l’agrément féministe, la question du mariage devrait être posée à toute personne qui s’engage dans ce combat. C’est pourtant ce qui est exigé aujourd’hui des femmes qui portent le voile et souhaitent prendre part au combat contre les violences faites aux femmes, pour le droit à l’IVG et la contraception... Nous pensons qu’il n’existe pas de préalable à l’engagement féministe : chacunE arrive avec ses expériences, ses exigences, sa culture... et son aliénation ! C’est dans la lutte et par le débat qu’on prend conscience des mécanismes d’oppression. Le collectif politique doit permettre de trouver les outils de libération... à condition qu’il soit bienveillant et à l’écoute des limites de chaque personne à un moment donné. La signature de textes explicites et fermes quant à leurs exigences féministes, la participation à des manifestations non ambiguës dans leurs objectifs féministes sont des actes suffisants pour être considérés féministes. Le port du voile par des femmes est une aliénation, ce n’est pas une raison pour dénier le droit d’être féministe aux femmes voilées.
PS. Suite au tollé que semble provoquer la mise en relation des aliénations du mariage et du voile, il nous paraît intéressant de rappeler qu’on nous opposait le caractère oppressif du mariage, institution hétéropatriarcale s’il en est, lorsqu’en 2004, nous nous mobilisions pour l’égalité des droits entre trans, homos et hétéros. Mais qui s’est alors engagé ou s’engage concrètement pour l’abolition du mariage pour tous ?
Pour être tenuE au courant de ce qui agite les Panthères, inscris-toi à la lettre d’infos.
Pour réagir à quelque chose qu’on aurait fait (ou pas fait), bien (ou pas bien), envoie un mél.
Notre adresse postale : Les Panthères roses - Maison des associations du 10ème - 206 quai de Valmy 75010 PARIS
Certaines fonctionnalités ne sont plus disponibles. Plus d'infos sur les Panthères roses ici: Les Panthères roses (Paris)
Notre adresse postale : Les Panthères roses - Maison des associations du 10ème - 206 quai de Valmy 75010 PARIS